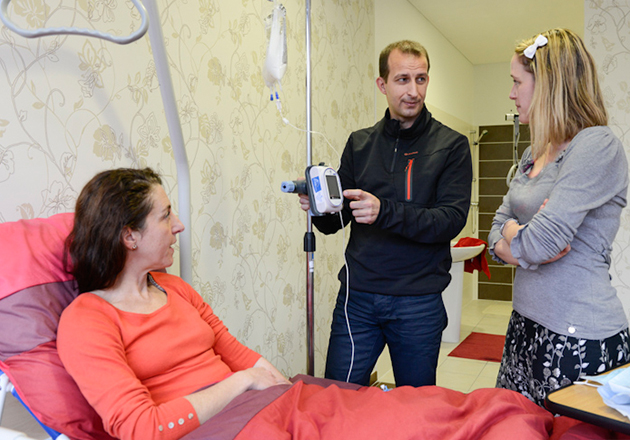Maillon essentiel de la chaîne de soin, les prestataires accompagnent chaque jour 1 550 000 patients à domicile. Ils répondent ainsi à l’aspiration des patients à être traités chez eux et participent à la mise en œuvre du virage ambulatoire.
Histoire
Les prestataires de santé à domicile (PSAD) ont vu le jour en France dans les années 70. Dans sa forme actuelle, ce secteur d’activité st le résultat d’un processus de maturation et de structuration qui s’est déroulé au cours des 30 ou 40 dernières années et dont le corps médical, les autorités de santé et les prestataires ont été les principaux acteurs.
C’est dans le domaine respiratoire que sont apparues lespremières prestations à domicile. Alors que les personnes souffrant de pathologies respiratoires chroniques étaient jusqu’alors exclusivement prises en charge à l’hôpital, les progrès techniques ont permis l’apparition, à partir de la fin des années 60, des premiers traitements d’oxygénothérapie et de ventilation assistée à domicile, proposés aux patients par des associations constituées à l’initiative de pneumologues et de réanimateurs hospitaliers.
En 1981, la création de l’ANTADIR, à la demande du ministère de la Santé et des caisses nationales d’assurance maladie, pour rationaliser et homogénéiser les modalités de délivrance de ces nouvelles prestations, marque le début de la structuration du secteur. Progressivement, le champ d’activité s’étend à de nouveau traitements dans le domaine respiratoire (ventilation non invasive, traitement de l’apnée du sommeil par pression positive continue…) puis, au-delà, à un ensemble de services destinés à permettre le maintien à domicile des patients (équipement du domicile, nutrition, insulinothérapie par pompe).
Aux côtés des associations, des acteurs issus du secteur privé entrent progressivement sur le marché à partir des années 90 et contribuent au développement de l’offre proposée aux patients.
-
2023
Proposition de loi visant à définir un statut des prestataires de santé à domicile déposée par le Sénateur Alain Milon
-
2022
Charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l'information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées
-
2021
Loi de financement de la sécurité sociale prévoyant l’obligation de certification par la HAS de tous les PSAD.
-
2020
COVID : prise en charge de 100 000 patients Covid nécessitant une oxygénothérapie à domicile
-
2019
Rapport de l’IGAS « Missions de prestataires de service et distributeurs de matériel »
-
2018
Nouvelle nomenclature pour le traitement de l’apnée du sommeil par PPC entérinant le télésuivi de l’observance des patients et la rémunération à la performance des PSAD.
-
2016
Nouvelle version des BPDOUM
Nouvelle convention entre l’Assurance Maladie
et les PSAD -
2014
Création du label de certification des prestataires de
santé à domicile « Quali’PSAD » -
2013
Création du SYNAPSAD autour de prestataires
associatifs anciennement adhérent au SNADOM -
2011
Arrêté relatif au contenu de la formation des
intervenants et garants des bonnes pratiques employés
par les PSAD -
2006
Arrêté et décret relatifs à l’obligation formation des
personnels des PSAD
-
2002
1ère convention régissant les rapports entre l’Assurance
Maladie et les PSAD (convention dite tiers-payant) -
2001
Création de l’Union Nationale des Prestataires de
Dispositifs Médicaux (UNPDM)
Création du Syndicat National des Associations d’aide à Domicile (SNADOM)
Le TIPS est remplacé par l’actuelle Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR, article L.165-1 du code de la sécurité sociale)
-
2000
Publication des bonnes pratiques de dispensation de
l’oxygène à usage médical à domicile (BPDOUM) -
années 2000
Insulinothérapie par pompe, nutrition entérale,
nutrition parentérale, perfusion pour parkinson, déficit
immunitaire -
années 90
Apnée du sommeil, chimiothérapie, SIDA,
antibiothérapie, mucoviscidose. -
début des années 80
Création de la prestation d’oxygénothérapie dans le
Tarif Interministériel des Prestations Sanitaires (TIPS,
ancêtre de la LPP) -
1981
Création de l’ANTADIR.
-
1969
Création du Synalam
-
années 60
Premiers patients dans le respiratoire
Description métier
Pour accompagner le vieillissement de la population et à l’accroissement de la prévalence des maladies chroniques,
les PSAD mettent en oeuvre les prestations et les technologies nécessaires aux traitements au domicile du patient,
tout en assurant l’interface avec les autres acteurs de santé.
Les PSAD, maillons essentiels de la chaîne de soins
La prestation de santé à domicile est globale et intègre tout au long de la prise en charge un ensemble de prestations et de services à destination du patient et de son entourage (notamment la formation et l'éducation) mais également un lien permanent avec les autres acteurs de santé, médicaux ou paramédicaux (médecins prescripteurs, médecin traitant, infirmier libéral, pharmacien).
Selon les cas, les PSAD peuvent intervenir auprès du patient, soit de manière directe sur demande du médecin prescripteur (cas le plus fréquent), soit pour le compte d'autres acteurs comme des pharmacies d'officine ou les structures d'hospitalisation à domicile (HAD), dans le cadre de contrats de sous-traitance.